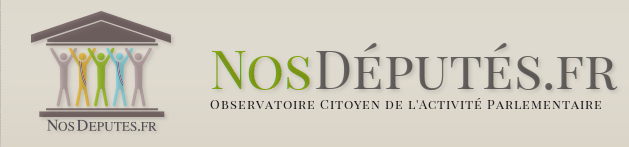Intervention de Jean-Daniel Lévy
Réunion du jeudi 25 janvier 2024 à 11h00
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Il m'apparaît également essentiel de nous demander si nous sommes aujourd'hui confrontés à un enjeu qui touche uniquement l'univers médiatique ou s'il concerne plutôt l'ensemble des acteurs qui prennent la parole dans l'espace public. Au regard des différentes enquêtes que nous réalisons, nous constatons que ce deuxième aspect est très prégnant. Cette défiance semble ainsi porter sur les acteurs qui interviennent dans l'espace public, soit qu'ils n'apparaissent pas sincères, soit parce que sous la justification d'une forme d'expertise, ils font valoir des opinions qui leur sont propres, soit encore parce qu'il pourrait exister des intérêts cachés dans le cadre de cette prise de parole. Dans nos enquêtes, qu'elles soient publiques ou confidentielles, nous observons que ce doute existe.
Dans le cadre des États généraux de l'information, nous avons conduit une étude qui met en avant un certain nombre d'aspects. En premier lieu, il existe encore un intérêt manifeste pour l'information. Nous le remarquons d'autant plus que chaque semaine, nous interrogeons de manière spontanée des Français sur les sujets qui les ont marqués. À chaque fois, nous sommes surpris par la richesse de la restitution qui peut en être faite par nos compatriotes. Cet intérêt ne porte pas forcément sur la rubrique des « chats écrasés » ou des faits divers, mais peut s'exercer sur de grands sujets internationaux, avec parfois une forme de décorrélation entre ce qui a marqué nos concitoyens dans l'actualité et la manière dont l'information est hiérarchisée, s'agissant en tout cas des grands médias traditionnels installés au niveau national.
Je le dis assez souvent : il est faux d'affirmer que les sujets internationaux n'intéressent pas nos compatriotes. Simplement, ils les intéressent d'une manière différente de celle des années 1970 ou 1980. Les événements qui se sont déroulés ou se déroulent en Syrie, en Israël, en Ukraine ou au Yémen constituent des sujets qui ressortent spontanément quand nous interrogeons nos compatriotes, alors même qu'ils ne sont pas toujours considérés comme étant des thèmes qui vont susciter de l'audience ou de l'intérêt par un certain nombre de directions éditoriales dans les grandes chaînes de télévision et de radio.
Il existe par ailleurs une forme d'interrogation qui, là aussi, ne touche pas uniquement l'univers du journalisme. Elle porte sur l'indépendance et la liberté des médias privés, mais également publics. Lors de cette même étude, nous avons été frappés de constater l'existence d'un léger « surplus » de confiance à l'égard des médias publics par rapport aux médias privés, qui demeure cependant limité à cinq à six points d'écart.
Nous observons donc un intérêt pour l'information, un doute concernant l'indépendance de la presse et la liberté des journalistes, mais également une difficulté à pouvoir se montrer confiant dans la véracité de l'information. Par exemple, 60 % des Français déclarent qu'il leur arrive assez fréquemment de rencontrer des difficultés pour savoir si les informations diffusées dans les médias sont vraies ou fausses. Cette interrogation sur l'émetteur en tant que tel, sur l'indépendance et la véracité des informations peuvent se traduire de différentes façons. De manière sous-jacente, le doute renvoie à une course à l'audience qui entraînerait la mise en avant de dimensions qui, sans être tronquées, se concentreraient uniquement sur des aspects spectaculaires.
Le troisième type d'interrogations porte sur la confrontation entre un « ancien monde », celui des médias traditionnels télévisuels et radiophoniques, et un « nouveau monde », les réseaux sociaux et l'environnement numérique.
Près de dix millions de Français regardent le journal télévisé (JT) de 20 heures des deux plus grandes chaînes. Si celui-ci est plus particulièrement suivi par les plus âgés, il demeure le plus grand prescripteur ou « influenceur ». Même si les jeunes générations recourent plus massivement aux « nouveaux médias » que sont internet et les différents réseaux sociaux, elles ne leur accordent pas une confiance qui viendrait supplanter l'information émise par les grands médias traditionnels.
Dans une société parfois un peu défaitiste qui peut être traversée par l'idée que « c'était mieux avant », plus d'un Français sur deux estime que les informations apparaissent aujourd'hui moins fiables que par le passé. La question de la multiplication des médias joue également un rôle : la confiance dans une information s'accroît lorsque celle-ci est présente sur différents médias, qu'elle n'est pas produite par un seul émetteur. Cette confiance progresse également dès lors que l'information apparaît comme neutre, qu'elle est évoquée par des sources officielles et qu'elle est corroborée par des données et par des expertises scientifiques. Cependant, il ne s'agit pas non plus d'une évidence absolue : un doute peut parfois demeurer à l'égard de la parole scientifique à proprement parler.
Enfin, s'il peut exister une défiance à l'égard des émetteurs, nous avons paradoxalement observé une confiance vis-à-vis des journalistes. Nous interprétons cet élément de la manière suivante : les Français estiment que les journalistes font individuellement preuve de bonne volonté, mais que les systèmes dans lesquels ils sont aujourd'hui engagés les empêchent de pouvoir mener globalement à bien leur mission.